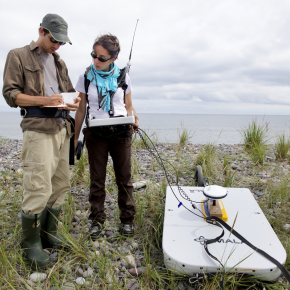Le BRGM et le CNRS, ensemble pour étudier le sous-sol
Depuis une quarantaine d’années, le BRGM et le CNRS œuvrent de concert sur les problématiques liées au sol et au sous-sol. À l’occasion du renouvellement de la convention quinquennale entre les deux institutions, le directeur scientifique du BRGM dresse le bilan des cinq dernières années, marquées par l’émergence des PEPR.
Quel est l’historique des liens entre le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et le CNRS ?
Philippe Freyssinet : Notre collaboration avec le CNRS remonte aux années 1980, tout d’abord avec l’établissement de la carte géologique de la France puis du référentiel géologique du pays. Nous avons beaucoup diversifié notre partenariat avec le CNRS depuis quelques années, au travers notamment de trois Programmes et équipements prioritaires de recherche (PEPR) exploratoires que nous copilotons avec le CNRS. Il s’agit de OneWater – Eau bien commun, de Risques et de Sous-Sol, bien commun. Ils représentent à eux trois 170 millions d’euros de financement et ont donné un essor extrêmement marqué à notre collaboration.
Quel bilan feriez-vous de ces cinq dernières années de convention avec le CNRS ?
P. F. : Le bilan est très positif ! Bien que le BRGM soit un établissement public à caractère industriel et commercial et le CNRS un établissement public à caractère scientifique et technologique, nous avons su dépasser les modèles économiques et statuts pour jouer de nos complémentarités en termes de positionnement scientifique. Cette synergie très performante a très bien fonctionné aussi bien pour la conception des PEPR que pour nos résultats au niveau européen.
Les PEPR sont des lieux de collaboration idéaux et interdisciplinaires, pour construire des partenariats innovants. Ces cinq dernières années, nous avons consolidé notre collaboration ancienne avec CNRS Terre & Univers, l’un des dix instituts du CNRS, mais nous avons aussi élargi nos échanges avec CNRS Écologie & Environnement et CNRS Sciences humaines & sociales, car les problématiques de ressources et d’environnement touchent de nombreuses questions sociétales.
La convention simplifie le partenariat en posant des bases et des principes de manière systématique, sans avoir besoin de le faire projet par projet. Ceci sert en particulier à nos deux unités communes : l’unité mixte de recherche (UMR), l’Institut des sciences de la Terre d’Orléans1 , qui abrite actuellement cinq projets ERC ; et l’unité d’appui et de recherche (UAR) Microscopies, imageries et ressources analytiques en région Centre-Val de Loire2 , pour laquelle le BRGM et le CNRS ont convenu d’une stratégie d’investissement sur d’importants équipements scientifiques.
Quels sont les apports de la nouvelle convention ?
P. F. : Nous avons élargi le champ scientifique de notre partenariat avec le CNRS, qui intègre désormais l’ensemble de notre stratégie scientifique au-delà de nos unités en commun.
Nous avons également un chantier en commun pour consolider des pôles d’excellences sur certains territoires, par exemple dans le domaine des risques ou des ressources minérales. Nous voudrions gagner en leadership européen sur ces questions grâce au soutien commun entre le BRGM et le CNRS. Nous faisons également partie de l’agence de programme Climat, biodiversité et sociétés durables, coordonnée par le CNRS, et nous souhaitons dans ce cadre nous investir plus à fond sur les problématiques d’adaptation au changement climatique.