Retrouvez tous les épisodes
La science s’invite dans l’actualité… et les chercheurs du CNRS nous aident à la décrypter !
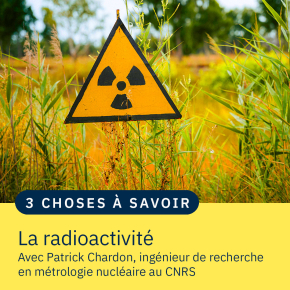
Dans le domaine médical comme dans celui de l’énergie, de la recherche ou de l’armement, la radioactivité est massivement utilisée. Cependant, la gestion de ses déchets est un enjeu majeur aux implications multiples. Alors qu'une mission scientifique est partie cartographier les fûts immergés de l'Atlantique, Patrick Chardon, ingénieur de recherche au CNRS en métrologie nucléaire, récapitule trois choses à savoir sur la radioactivité et les déchets radioactifs.
La radioactivité est liée au fait que certains atomes (radionucléides) sont instables et ont la propriété de se désintégrer et de se transformer en un autre atome en émettant un rayonnement. Il faut savoir que la radioactivité est naturellement présente tout autour de nous : on y est exposé en permanence, mais à un niveau raisonnable. Elle devient dangereuse quand la dose augmente : plus l’intensité de l’exposition à un élément radioactif est forte et plus la durée de cette exposition est longue, plus les effets seront néfastes. A haute dose, la radioactivité peut être mortelle, induire des brûlures, détruire des cellules ou des noyaux de cellules, endommager l’ADN, voire le rompre et générer, à plus ou moins long terme, des cancers.
Un déchet radioactif est le résidu d’une activité humaine qui ne peut plus être utilisé ou valorisé et qui présente la caractéristique d’être radioactif. Certains ont des durées de vie de quelques secondes ou de quelques heures, d’autres de plusieurs dizaines de milliers d’années. Chacun va être traité différemment. En France, les déchets radioactifs de faible durée de vie (issus principalement du domaine médical) sont gérés par simple décroissance, les autres déchets nucléaires et radioactifs sont collectés, traités et mis en sécurité par une agence spécialisée : l’ANDRA. Les déchets radioactifs à durée courte et moyenne sont stockés en surface pendant environ 300 ans. Bien qu’ils ne représentent qu’une faible part des déchets radioactifs, les déchets à très haute concentration en radionucléides, comme ceux issus du retraitement du combustible des centrales nucléaires, vont devoir être isolés pendant des centaines de milliers d’années !
Pour stocker les déchets fortement concentrés, la stratégie privilégiée par la France est l’enfouissement. Le principe serait de les isoler dans des structures géologiques qui sont réputées stables sur du très long terme et de prévoir des systèmes de confinement permettant à la radioactivité de décroitre au fil du temps sans entrer en contact avec l’environnement ni remonter à la surface. L’enjeu est de taille car il faut réussir à se projeter dans le temps : comment les générations futures géreront les déchets que nous avons produits, comment l’information sur le stockage de ces déchets radioactifs pourra se transmettre de génération en génération ? En ce moment, la mission Nodssum à laquelle je participe, explore les grands fonds marins où ont été immergés des fûts radioactifs entre 1950 et 1990. A l’époque, cela paraissait une bonne idée. Aujourd’hui, on prélève des échantillons pour mieux comprendre les effets sur les écosystèmes.
Patrick Chardon est ingénieur de recherche au CNRS en métrologie nucléaire, affecté au Laboratoire de physique de Clermont-Auvergne (LPCA). Il mesure ou calcule les différents niveaux de radioactivité rayonnée en un lieu, et les doses reçues par les organismes vivants.
La science s’invite dans l’actualité… et les chercheurs du CNRS nous aident à la décrypter !