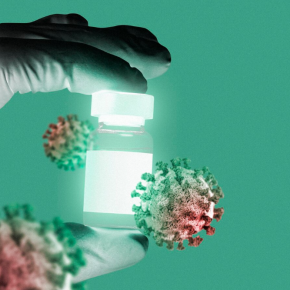« Ces sujets posent une même question, celle de la responsabilité des scientifiques »
Le Comité d’éthique du CNRS publie un nouvel avis intitulé « Manipuler les virus, manipuler le climat ? Comment juger de ce qui est responsable en recherche ? » qui interroge les limites de certaines expérimentations à haut risque, telles que les gains de fonctions pour la modification de virus en laboratoire, ou les techniques de géoingénierie. Christine Noiville, présidente du COMETS en détaille les ambitions et enjeux.
Pourquoi avoir choisi d’aborder dans un même avis deux sujets si différents ?
Christine Noiville : Effectivement, ces deux sujets n’ont apparemment rien à voir. En virologie, les gains de fonction renvoient à des expériences en laboratoire sur des bactéries ou des virus rendus plus pathogènes ou plus transmissibles par des scientifiques qui cherchent à mieux en comprendre leur fonctionnement et leur potentiel pandémique. Cela soulève des questions de sécurité des laboratoires qui ne datent pas d’hier. La géo-ingénierie solaire, elle, est un ensemble de techniques très variées et pour certaines récentes, qui visent à manipuler à grande échelle l’environnement planétaire pour contrecarrer le changement climatique. Parmi ces techniques, le COMETS s’intéresse particulièrement à la modification du rayonnement solaire par l’injection d’aérosols dans la stratosphère pour lesquelles les réflexions sont beaucoup moins matures.
Mais malgré ces différences, les deux sujets posent une même question, celle de la responsabilité des scientifiques quand leurs recherches peuvent présenter des risques collectifs à grande échelle soit directement, soit indirectement, en l’occurrence laisser échapper un virus à potentiel pandémique mondial, déstabiliser le climat dans certaines régions, provoquer un effet rebond du réchauffement en cas d’arrêt des injections…. Ce n’est pas une question nouvelle mais elle se pose ici de manière très aigue et divise les communautés scientifiques, en France et dans le monde. Est-il raisonnable d’exposer les populations et l’environnement à des risques de dommages majeurs ? La recherche doit-elle au contraire être au rendez-vous des enjeux cruciaux que représentent en l’occurrence la lutte contre les pandémies et le changement climatique, y compris en menant des expériences potentiellement dangereuses ?
Les hésitations et les controverses sont d’autant plus vives que dans les deux cas, le débat est enchâssé dans un contexte politico-économique qui radicalise le débat. Derrière la question des gains de fonction planent en effet les craintes que suscitent le bioterrorisme mais aussi la pandémie de COVID, que certains attribuent à un accident de laboratoire. Quant à la modification du rayonnement solaire, on la suspecte d’être poussée par des acteurs privés dont l’intérêt véritable est de maintenir un modèle fondé sur les énergies fossiles et qui n’entraînent la recherche publique sur ce terrain que pour faire diversion plutôt que pour faire progresser la décarbonation. D’où des débats polarisés, y compris au CNRS, sur le point de savoir s’il convient de conduire des recherches dans ces domaines.
S’agit-il de questions éthiques ?
C. N. : Pas seulement, bien sûr. Ces questions ont évidemment une dimension scientifique et politique. Mais elles mettent en jeu des principes valeurs très opposées (liberté de la recherche scientifique, non-nuisance, justice, équité, etc.), n’appellent pas de réponse toute faite et exigent de réfléchir ensemble à la moins mauvaise solution au plan collectif, au monde que l’on veut pour demain et aux valeurs qui sous-tendent nos choix. C’est la mission même du COMETS que de faire en sorte que le secteur de la recherche scientifique soit au cœur de cette réflexion. Et ce n’est donc pas un hasard si la direction du CNRS a choisi de transformer en saisine ce qui était à l’origine une auto-saisine du COMETS.
Que recommande le COMETS ?
C. N. : Le COMETS formule trois recommandations principales.
Il considère d’abord qu’il relève de la responsabilité des scientifiques d’instruire collectivement ces questions à potentiel de risque élevé et de s’interroger ensemble, de manière coordonnée, sur les risques et les bénéfices sociétaux à faire de la recherche sur ces sujets. Nous, scientifiques, n’avons pas pour mission unique de produire des connaissances en nous désintéressant de leurs conséquences au motif que la connaissance serait neutre, ce qui, en fait, n’est pas le cas. Nous avons la responsabilité de réfléchir aux impacts directs ou indirects de nos projets de recherche et d’éclairer les débats et décisions publiques. C’est crucial pour éviter que des questions controversées comme celles qu’aborde le COMETS dans cet avis ne soient captées par des intérêts particuliers, qu'ils soient académico-scientifiques, industriels ou politiques.
Ensuite, le COMETS recommande que cette instruction soit multidisciplinaire, de façon à prendre en compte l’ensemble des problèmes qui se posent. Que l’on parle d’expériences de virologie ou de modification du rayonnement solaire, les questions en jeu sont rarement d’ordre purement scientifique et technique. Elles sont aussi politiques, sociales et éthiques, ne serait-ce que parce qu’elles impliquent une réflexion sur l’acceptabilité des risques, sur les enjeux géopolitiques, sur l’encadrement au plan mondial.
Enfin, tout domaine de recherche présentant des risques collectifs élevés appelle des règles particulières en termes de gouvernance de la recherche. C’est d’autant plus indispensable lorsque les risques sont à grande échelle mais qu’il n’existe pas de cadre juridique international partagé. Par gouvernance de la recherche, il faut comprendre le respect, par les scientifiques, des obligations éthiques et déontologiques qui leur incombent (intégrité scientifique, déclaration des liens d’intérêts, transparence des financements des recherches…). Il doit en effet être particulièrement scrupuleux s’agissant de recherches à risques controversées et encore plus lorsqu’elles sont sous-tendues par de puissantes forces économiques et politiques. Il faut y ajouter la nécessité de mettre en place, pour tout projet de recherche à risques, des dispositifs d’évaluation, de suivi, de retours d’expériences, et des portes de sortie si la recherche se révèle trop risquée. De même, la coopération scientifique au plan supra-national est capitale dans des domaines où les risques s’avèrent mondiaux. Tout comme est crucial le renforcement et la structuration d’espaces d’échanges entre scientifiques, décideurs et société civile, dans lesquels les préoccupations des décideurs et de la société puissent être entendues et les priorités de recherche discutées. Il est normal que les communautés scientifiques determinent elles-mêmes les modalités de leurs travaux de recherche. Mais s’agissant de recherches à risques socialement dangereuses, les finalités méritent d’être largement discutées.
Concrètement, pour les recherches sur les gains de fonction, comment devrait se décliner cette approche responsable ?
C. N. : Pour les expériences de biologie susceptibles de présenter des risques élevés telles que les expériences de gain de fonction, CNRS Biologie met actuellement en place un comité de pairs chargé d’évaluer au cas par cas les risques et les bénéfices de tout projet d’expérimentation de ce type mené au CNRS. Pour le COMETS, il s’agit bien d'une approche responsable d’instruction collégiale, si tant est qu’elle satisfasse à plusieurs conditions. La direction du CNRS devrait notamment travailler à ce que les personnels de recherche connaissent et respectent ce nouveau dispositif. Il faut par ailleurs éviter l’entre-soi dans ce comité de pairs, faire en sorte que puissent s’y exprimer des savoirs et des points de vue complémentaires, y compris une dimension éthique, juridique et sociétale, comme dans les comités de protection des personnes en matière de recherche biomédicale. Le COMETS insiste aussi sur le suivi des projets et leur réexamen à des jalons réguliers, de sorte qu’il soit à tout moment possible de mettre un terme l’expérimentation si nécessaire. Une collaboration étroite entre le CNRS et les autres instituts de recherche devrait en outre être structurée afin d’assurer une veille et une coordination continues. Enfin, il est important de poursuivre les démarches pour que dans le cadre d’une institution internationale, l’OMS par exemple – même si cette instance est actuellement fragilisée, les scientifiques travaillent à un socle commun d’évaluation et de gestion des risques au regard des connaissances acquises.
Et pour la modification du rayonnement solaire, que recommandez-vous ?
C. N. : Le positionnement que devrait adopter le CNRS sur ce sujet – et la recherche publique en général – fait l’objet d’oppositions frontales entre ceux qui, comme les universités de Harvard ou de Cambridge, ont fait le choix d’investir la question et ceux qui, au contraire, estiment qu’il faut s’en abstenir, toute recherche sur la MRS (Modification du Rayonnement Solaire) tendant à cautionner, voire à stimuler le développement de technique d’expérimentation.
Dans l’éventail des possibles (s’interdire toute recherche sur la MRS, prototyper les techniques et mener des expériences de terrain, etc.), le COMETS choisit clairement l’option qui consiste à financer des recherches sur la question. A ses yeux, le fait d’entreprendre ces recherches entraîne bien une responsabilité éthique. Elles ne doivent pas se faire au détriment mais en complément des recherches sur les modes plus classiques de lutte contre le changement climatique et ses causes (captation de carbone, reforestation, atténuation…). Elles ne visent pas davantage de prototyper les techniques et, pour l’instant, sans doute même pas pour les tester en milieu réel. Il s’agit plutôt d’opérer une veille des projets en cours dans le monde, pour se doter des moyens de détecter les essais et les déploiements, pour en documenter les risques et les bénéfices, et pour instruire les questions socio-politiques qui en découlent : acceptabilité des populations, enjeux géostratégiques, gouvernance internationale, responsabilité, etc. Actuellement, on sait qu’il n’existe pas de règles internationales permettant d’éviter que des acteurs, Etats ou entreprises agissent de façon unilatérale, ce qui risque de causer des dommages à d’autres Etats. Comme la situation mondiale ne laisse guère escompter l’adoption prochaine d’un cadre international partagé il s’avère donc crucial de penser les questions de surveillance et de responsabilité. Si un Etat entreprenait des expérimentations causant des dommages, comment pourrait-on établir le lien de causalité ?
Les membres du COMETS pensent en effet essentiel de ne pas laisser le sujet entre les mains d’Etats ou d’entreprises qui promeuvent la MRS et auraient donc intérêt à mettre en avant des données qui leur seraient favorables. Il est au contraire de la responsabilité des scientifiques de produire des données robustes et impartiales pour éclairer les choix collectifs. C’est pourquoi l’avis accueille favorablement la mission qui vient d’être précisément créée à cet effet au sein de l’agence de programme « Climat, biodiversité et sociétés durables », coordonnée par le CNRS. S'agissant de recherche à haut risque, le COMETS tient tout d'abord à rappeler combien il est important que les travaux dans ce domaine obéissent aux obligations éthiques et déontologiques de déclaration des liens d’intérêts, de transparence des financements, d’indépendance des évaluations, afin de garantir une construction de choix collectifs en confiance. Par ailleurs, ce travail devrait favoriser autant que possible la coopération scientifique internationale. Même si elle est actuellement mise à rude épreuve, celle-ci s’avère nécessaire pour mettre en place des réseaux de surveillance, de partage des données, d’élaboration de normes communes, d’évaluation des risques. Enfin, nous insistons sur la nécessité de structurer et de renforcer des espaces d’échanges avec le milieu politique mais aussi avec la société civile. Etant donné les incertitudes qui entourent la MRS et sa gouvernance, il s’agit de construire en confiance avec la société civile un socle commun de connaissances, d’explorer les enjeux et les réponses envisageables, de choisir collectivement les voies de recherche à prioriser en fonction du monde que nous souhaitons pour demain.