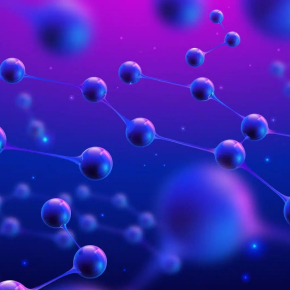PFAS : quand dépollution rime avec innovation
Omniprésents, persistants, invisibles, les PFAS s’imposent comme l’un des défis environnementaux majeurs de la décennie. Autour du CNRS, un écosystème unique se mobilise : chercheurs, deeptechs et industriels unissent leurs compétences pour inventer les solutions de dépollution de demain.
Pour saisir l’ampleur du défi de la lutte contre les PFAS, il importe de brosser les principales caractéristiques de ces composés chimiques. Ces substances per- et polyfluoroalkylées, sont utilisées depuis les années 1950 pour leurs propriétés antiadhésives, imperméabilisantes ou encore résistantes aux fortes chaleurs. Présents dans une multitude de produits industriels et de consommation courante – emballages alimentaires, poêles, textiles, cosmétiques, mousses anti-incendie, batteries ou peintures –, les PFAS doivent leur succès à une liaison carbone-fluor très solide qui les rend quasi indestructibles dans l’environnement.
Cette stabilité exceptionnelle, leur conférant le surnom de « polluants éternels », est aussi leur principal défaut : les PFAS ne se dégradent pas naturellement, s’accumulent dans les sols, les eaux, l’air, les organismes vivants et jusque dans notre sang. Certains de ces composés ont déjà été interdits, en raison de leur toxicité. Pour complexifier encore la situation, les PFAS se présentent sous des milliers de formes aux comportements chimiques différents. Par ailleurs, les traitements d’élimination des PFAS sont extrêmement coûteux : selon une vaste enquête menée par le quotidien Le Monde, débarrasser les eaux et les sols européens des PFAS coûterait entre 95 et 2000 milliards d'euros en 20 ans. Au coût financier s’ajoute celui énergétique, une préoccupation tout aussi essentielle. « Aujourd’hui, les PFAS peuvent être détruits majoritairement par voie thermique, c’est-à-dire par incinération à des températures au-delà de 1100°C, un processus extrêmement énergivore », explique Sébastien Lagoutte, Responsable de la coopération pour la filière Chimie et Matériaux au sein de la Direction des relations avec les entreprises du CNRS. « C’est pourquoi nous finançons des recherches par le biais de l’appel à projet PFAS porté par la MITI et la DRE ou d’autres collaborations avec des industriels qui investiguent de nouvelles voies de dégradation en essayant de trouver le meilleur compromis entre coût financier, coût énergétique, efficacité de destruction et absence de génération de nouvelles pollutions. »
Le décor ainsi exposé, on comprend aisément que la lutte contre la pollution des PFAS constitue non seulement un impératif mais un défi scientifique et sociétal considérable à l’échelle mondiale. « PFAS : enjeux de la dépollution », la journée d’étude organisée le 6 octobre dernier par la Direction des Relations avec les Entreprises (DRE) et la Mission pour les Initiatives transverses et interdisciplinaires (MITI) du CNRS a permis de partager des constats, de présenter des projets innovants et de dessiner des perspectives.
En la matière, la solution tient en un mot : innovation. C’est pourquoi, le fleuron français de la recherche scientifique, des laboratoires publics européens, des laboratoires privés, des industriels et des start-up se mobilisent ensemble pour concevoir de nouvelles stratégies de dépollution, capables d’extraire et de détruire ces polluants persistants afin de préserver durablement la ressource en eau. Tour d’horizon d’approches innovantes.
Simuler la dégradation au cœur de la molécule
Pour s’attaquer aux PFAS, la deeptech MS4ALL (Molecular Simulation for All) propose une approche fondée sur la dynamique moléculaire réactive, capable de simuler les réactions chimiques qui conduisent à la dégradation complète des polluants. « Si on veut dégrader des molécules, les convertir ou les traiter, on met en œuvre une réaction chimique spécifique », explique Pascal Brault, chercheur au CNRS, cofondateur et conseiller scientifique de la start-up. Et de poursuivre : « On crée une boîte de simulation, plus petite qu’un micron, on y met tous les ingrédients, on initie le calcul des interactions et on analyse les produits ». C’est le principe de la dynamique moléculaire réactive. L’enjeu est de comprendre la réaction de dégradation des PFAS pour anticiper les produits formés et éviter d’en créer de nouveaux plus dangereux. « Le danger, c’est de couper une molécule polluante en deux et d’obtenir deux polluants », souligne le chercheur.
Grâce à ce microscope virtuel, MS4ALL fournit un outil prédictif de dégradation capable d’accompagner les acteurs de la dépollution avant le stade de l’expérimentation en laboratoire. « On va simuler des situations réalistes, on peut visualiser comment les atomes bougent et réagissent dans le temps », décrit Pascal Brault. Il ajoute : « l’idée, c’est de comprendre ce qui se passe avant, pour mieux orienter les choix de traitement ». La simulation permet ainsi d’identifier les voies de destruction les plus efficaces et de repérer la formation de sous-produits comme le TFA, encore plus persistants.
Pour Edouard Lété, CEO et cofondateur de MS4ALL, la simulation moléculaire permet de « réduire drastiquement le nombre d’expériences physiques nécessaires. Nous ne remplaçons pas l’expérimentation, nous l’accélérons ». L’objectif est de rendre cette puissance de calcul accessible à un large public de professionnels de la recherche et de l’industrie. « Aujourd’hui, nos utilisateurs, ce sont des chercheurs, des ingénieurs procédés, des industriels de l’eau ou des matériaux qui veulent comprendre comment leurs molécules vont se comporter avant même de faire les essais expérimentaux ». En 2026, à l'occasion du salon CGLE à Rennes, la deeptech lancera MS4Nature, plateforme en ligne capable d’analyser toujours plus de molécules, dont les PFAS.
© MS4ALL
Filtrer grâce aux membranes
À l’Institut européen des membranes (IEM – CNRS / Université de Montpellier), Julie Mendret, maître de conférence à l’Université de Montpellier, explore une approche innovante pour lutter contre les « polluants éternels » présents dans l’eau. « Le procédé de filtration membranaire permet de retenir les molécules les plus persistantes. On applique ensuite une technique de dégradation au retentat pour briser les liaisons carbone-fluor », explique la scientifique. Cette approche constitue le socle du projet de recherche ZEROPFA4SREUT, financé par le CNRS, qui vise à réduire la présence des PFAS en sortie de station d’épuration pour permettre la réutilisation des eaux usées traitées pour la recharge des nappes phréatiques, en vue d’une potabilisation indirecte. Coordonné par Julie Mendret de l’IEM, il associe le BRGM, l’Institut de physique du globe de Paris et la start-up SinapTec.
La démarche repose sur une filière hybride articulant séparation, dégradation et épuration naturelle. « Grâce aux membranes de nanofiltration, les PFAS sont isolés dans un petit volume d’eau concentrée, qui peut ensuite être traité par électrochimie et sonolyse », décrit Julie Mendret. L’équipe prévoit d’utiliser des réacteurs à flux continu pour améliorer le transport de masse. La cavitation ultrasonique en mode continu sera testée pour dégrader les PFAS. La dernière étape du projet mobilise des solutions fondées sur la nature : « Nous injecterons le liquide épuré dans le sol pour évaluer la dégradation naturelle des PFAS après l’étape d’oxydation », précise la chercheuse. L’ambition du projet est de minimiser les sous-produits toxiques et la consommation d’énergie afin de proposer une technologie durable capable de produire une eau de haute qualité, compatible avec la potabilisation indirecte. Ce projet illustre la nécessaire dynamique collective entre les laboratoires publics français et européen, les start-up, et les établissements publics pour dépolluer l’eau des PFAS.

©Treewater
Détruire les PFAS à la source
Spécialisée dans la dépollution des effluents, la société lyonnaise TreeWater développe des procédés capables de détruire totalement les PFAS, là où les technologies conventionnelles ne font que les concentrer. Deux procédés sont aujourd’hui à un haut niveau de maturité : la réduction avancée, basée sur la production d’électrons hydratés, et l’électro-oxydation, issue d’un brevet CNRS porté par Emmanuel Mousset au sein du laboratoire GEPEA, avec lequel TreeWater collabore étroitement. « Notre technologie d’électro-oxydation Electrotate permet d’attaquer directement la molécule de PFAS, casser la liaison carbone-fluor et obtenir in fine une minéralisation complète », explique Bruno Cedat, cofondateur et directeur technique de la start-up. Et d’ajouter : « nous pouvons détruire quasi intégralement une trentaine de PFAS réglementaires à chaîne longue mais également à chaîne ultra courte comme le TFA ». La mise en rotation des électrodes diminue significativement la consommation énergétique du procédé.
TreeWater s’apprête à franchir une étape décisive. La start-up déploie en effet des pilotes industriels en France sur des sites pollués et prévoit une commercialisation des procédés à l’horizon 2027.
TreeWater s’inscrit dans un vaste écosytème. « Tout est complémentaire. Sur la partie destructive, nous collaborons avec Emmanuel Mousset du GEPEA (CNRS) qui encadre la thèse de Myriam Kellou chez nous - nous travaillons d’ailleurs sur le lancement d’un laboratoire commun entre TreeWater et le GEPEA. Sur la mesure des PFAS, nous coopérons avec l’Université de Limoges et l’Ecole nationale de chimie de Rennes. Sur la modélisation des réactions, nous sommes en discussion avec MS4ALL. Treewater apporte son expertise sur la partie industrialisation. Enfin, nous constituons des partenariats avec des start-up pour la mesure des PFAS en temps réel et le suivi de l’efficacité de notre solution », décrit Bruno Cedat qui pilote la R&D de TreeWater.
La réglementation européenne rend cette synergie essentielle. « Si les contraintes s’imposent aux industries, il faut qu’il y ait des solutions disponibles pour pouvoir les traiter », conclut Bruno Cedat.
Les industriels, partenaires stratégiques de la dépollution
Face à l’ampleur de la pollution par les PFAS et aux défis techniques de leur traitement, le CNRS mise sur une approche partenariale d’envergure, en mobilisant les acteurs industriels de référence du secteur de l’eau et des déchets. Deux accords-cadres signés en 2025 avec les acteurs majeurs du secteur, SUEZ et Veolia, illustrent cette stratégie de recherche et d’innovation par le partenariat.
Ces collaborations visent à conjuguer l’excellence scientifique du CNRS et la capacité d’ingénierie et de déploiement industriel pour accélérer la mise au point de procédés de dépollution et de surveillance des milieux. Parmi les priorités : la caractérisation non ciblée des PFAS, au-delà des listes réglementaires, le traitement avancé des micropolluants, la valorisation des boues d’épuration, et l’usage de l’intelligence artificielle pour anticiper les risques environnementaux. Autant de projets qui visent à passer de la recherche fondamentale à la démonstration industrielle.
On l’aura compris, la science est au rendez-vous du défi écologique et sanitaire lancé par les PFAS. Il n’y aura pas de dépollution sans innovation, laquelle repose sur la coopération entre acteurs.