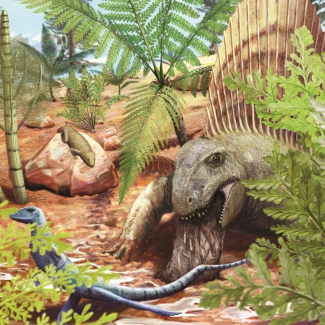JUNO : un détecteur géant pour percer les mystères des neutrinos
|
JUNO, un détecteur de neutrinos géant de nouvelle génération, vient de démarrer sa prise de données. Issu d’une collaboration internationale basée en Chine, à laquelle participe le CNRS pour la France, il traquera pendant les dix prochaines années avec une précision et une efficacité inédites les neutrinos, une des particules élémentaires les plus énigmatiques de l’Univers. Les données collectées permettront de franchir un cap décisif dans la connaissance de ces particules, qui sont une clé majeure pour comprendre la composition de l’Univers et son évolution, ou encore le monde subatomique.
La mise en service du détecteur géant JUNO (Jiangmen Underground Neutrino Observatory) s’inscrit dans une longue quête amorcée il y a près de 90 ans : parvenir à décrire les propriétés des neutrinos et comprendre le rôle qu’ils jouent dans le fonctionnement de notre Univers. En effet, il s’agit des particules élémentaires les plus abondantes de l’Univers. Rien que pour les neutrinos émis par le Soleil, on estime qu’environ 400 000 milliards de ces particules nous traversent chaque seconde. Cependant nous ne les ressentons pas car les neutrinos n’interagissent quasiment pas avec la matière. Aussi, il est très difficile de les détecter et c’est pourquoi, bien que ces particules aient fait l’objet de nombreuses recherches depuis des décennies, on ne sait encore que très peu de choses sur elles et leurs comportements. Il a ainsi pu être établi qu’il en existe trois types, qu’elles ont des masses infimes - mais qu’aucune expérience n’est parvenue à préciser -, et qu’elles sont capables de changer d’un type à l’autre à mesure qu’elles voyagent, un phénomène appelé oscillation. Pour compliquer la tâche, les neutrinos sont des particules neutres, qui ne produisent aucun signal direct dans les détecteurs. Les scientifiques doivent se contenter d’observer le résultat de leurs rares interactions avec d’autres particules. Le détecteur géant JUNO, conçu par la collaboration internationale, mobilisant en France plusieurs laboratoires du CNRS, utilise l’une de ces méthodes de détection indirecte à très grande échelle et dans des conditions optimisées pour multiplier les détections et en améliorer la précision.
Situé à 700 mètres sous terre entre les puissantes centrales nucléaires de Yangjian et de Taishan – deux sources constantes et abondantes de neutrinos artificiels – ce détecteur unique au monde est composé d’une cuve sphérique transparente de 35,4 mètres de diamètre remplie de 20 000 tonnes d’un liquide particulièrement sensible dans lequel toute interaction d’un neutrino avec le milieu donne lieu à des scintillements. Chaque manifestation lumineuse y est scrutée en continu par quelques 43 212 photomultiplicateurs, des détecteurs de lumière sensibles au moindre photon, disposés tout autour de la sphère transparente. C’est le signal combiné de ces dizaines de milliers d’yeux, qui permet de remonter jusqu’aux propriétés des neutrinos à l’origine de ces flashs. La cuve est elle-même immergée dans une piscine d’eau ultra pure de 44m de diamètre et coiffée d’un vaste dispositif appelé « Top tracker », permettant d’identifier et de caractériser le passage dans le détecteur de particules parasites comme les muons cosmiques, afin d’éviter toute confusion avec les signaux de neutrinos des centrales.
Pendant environ 10 ans, ce détecteur se consacrera principalement à la caractérisation la plus précise possible du phénomène d’oscillation des neutrinos. Les physiciens et physiciennes chercheront notamment à quelle fréquence exacte les neutrinos des réacteurs passent d’une forme à une autre. Plus cette mesure s’avèrera précise, plus les scientifiques seront à même d’en déduire d’autres valeurs qui en dépendent. L’une d’elle fait l’objet de toutes les attentions : l’ordre de masse des trois types de neutrinos, autrement dit, lequel est le plus massif des trois et lequel est le moins massif. La réponse « logique » voudrait qu’elle respecte l’ordre des masses des autres particules, mais la physique des neutrinos s’avère si déconcertante, qu’un ordre différent pourrait bien venir surprendre les scientifiques.
Au-delà de la connaissance intime des neutrinos, cette quête de longue haleine est un enjeu clé pour de nombreux domaines de la physique. En cosmologie, ils sont des acteurs incontournables dans les mécanismes de l’Univers, tels que l’inflation brutale de l’Univers dans ses premiers instants ou la disparition de l’antimatière au profit de la matière. En astrophysique, ils sont les témoins centraux des cataclysmes stellaires tels que les supernovæ. Ils en sont même la première manifestation, précédant l’énorme flash lumineux, faisant d’eux des « donneurs d’alerte » pour les astronomes. Plus proches de nous, les neutrinos nous aident à mieux comprendre les phénomènes nucléaires à l’œuvre au cœur du Soleil. D’autres de ces particules, produites par la radioactivité naturelle des roches, nous apportent un aperçu précieux et inédit sur les profondeurs du globe terrestre. JUNO sera le détecteur le plus sensible à ces neutrinos jamais mis en œuvre.
L’expérience JUNO est le produit d’une collaboration internationale regroupant 74 institutions d’Asie, d’Europe et d’Amérique et compte environ 700 membres. Elle est conduite par l’Académie des sciences chinoise (CAS) via l’Institute of High Energy Physics (IHEP). Son porte-parole Yifang Wang est également fellow-ambassadeur au CNRS. Les laboratoires du CNRS ont été impliqués à chaque étape de l’expérience. De la conception et à la construction du détecteur en passant par son exploitation, ils ont joué un rôle clé lors de la phase de démarrage et continueront d’occuper une place centrale tout au long de la mission à travers le pilotage, la maintenance et l’exploitation scientifique des données de l’expérience.
En France, six laboratoires du CNRS sont investis dans le projet :
|
Ressources :
Plus d’informations sur le site du CNRS :
https://www.in2p3.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/juno-un-geant-pour-ecouter-la-discrete-valse-des-neutrinos
Infographie de vulgarisation de l’expérience JUNO : https://www.in2p3.cnrs.fr/sites/institut_in2p3/files/news/2025-09/infographie_JUNO.pdf
Nombreuses images de la construction de l’expérience disponibles sur la photothèque IN2P3 : https://phototheque.in2p3.fr/index.php?/category/2032
Vidéo :
Timelapse de la construction du détecteur – vidéo Collaboration JUNO
https://youtu.be/yDIsoEUiXzc
Photos : https://ihepbox.ihep.ac.cn/ihepbox/index.php/s/1N7SygyISferUIN