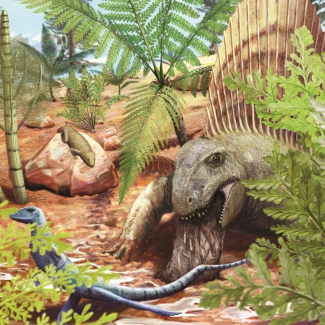Vers un renforcement coordonné de la recherche scientifique polaire : l’Institut polaire français rejoint l’Ifremer, et le CNRS anime la communauté scientifique
L’Institut polaire français, l’Ifremer et le CNRS s’allient pour renforcer le leadership scientifique de la France dans l’étude des pôles et de leur rôle dans le système climatique, l’évolution de leur biodiversité et les effets des changements en cours sur les sociétés. Cette alliance se concrétise par deux actions : sous la direction de David Renault nommé le 11 juillet 2025, l’Institut polaire deviendra une très grande infrastructure de recherche (IR*) rattachée à l’Ifremer d'ici la fin 2026. L'animation scientifique de la recherche polaire sera coordonnée par le CNRS, qui a récemment publié la première stratégie de la recherche polaire française.
Les régions polaires subissent des transformations rapides et inédites sous l’effet du dérèglement climatique et des autres impacts des activités humaines, avec des conséquences majeures sur les écosystèmes, les populations locales. Ces changements plus rapides qu’anticipés soulignent la nécessité d’intensifier la recherche pour mieux en comprendre la dynamique et les impacts.
Chaque année, plusieurs centaines de chercheuses et chercheurs bénéficient du soutien de l’Institut polaire pour rejoindre les stations de recherche polaires où ils effectuent des recherches inédites non seulement sur le climat, l’environnement terrestre et marin, la biodiversité, la géologie, mais aussi en astronomie, sismologie ou encore biologie humaine.
Successeur des expéditions polaires françaises de Paul-Émile Victor, l’Institut polaire français a, depuis sa création en 1992, mis en œuvre chaque année plus de 80 projets scientifiques. La recherche polaire française a un niveau d’excellence reconnu grâce au savoir-faire des équipes de l’Institut polaire, qui accueillent chercheuses et chercheurs dans 6 stations scientifiques de part et d’autre du globe : des stations Dumont d’Urville et Concordia (franco-italienne) en Antarctique à la station AWIPEV (franco-allemande) en Arctique sans oublier les trois stations de Port-aux-Français dans l’archipel de Kerguelen, Port-Alfred dans l’archipel de Crozet et Martin-de-Viviès sur l’île d’Amsterdam administrées par les Terres australes et antarctiques françaises, où l’Institut polaire assure également la maintenance et le ravitaillement d’une quarantaine de refuges et sites isolés.
Jean-Luc Moullet, directeur général de la recherche et de l’innovation du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : « La recherche polaire française se distingue à l’échelle internationale par son excellence scientifique et sa diversité disciplinaire. Elle doit continuer à bénéficier d’infrastructures de recherche de qualité. C’est tout le sens des mesures qui ont été annoncées. Elles visent en premier lieu à renforcer la coordination de l’animation scientifique de la recherche polaire en affirmant le rôle du CNRS en la matière, en termes de prospective et de développement d’une vision programmatique pour la recherche polaire. Par ailleurs, s’agissant de l’IPEV, qui joue un rôle central de soutien à cette recherche polaire française d’excellence, il s’agit de renforcer sa pérennité en tant qu’opérateur logistique. Cela se traduit par un projet à trois étages :
Labelliser l’IPEV comme IR* de manière à reconnaitre l’importance nationale de cette infrastructure de recherche ;
Intégrer l’Ifremer en tant que direction dédiée de manière à bénéficier des synergies apportées par une organisation plus établie ;
Nommer un nouveau directeur qui aura la responsabilité de conduire ce projet ».
L’Institut polaire français sera rattaché à l’Ifremer sous la direction de David Renault
Le 11 juillet, lors de l’assemblée générale de l’Institut polaire, David Renault, professeur de l’Université de Rennes, a été nommé directeur. Déjà soutenu par le CNRS qui y affecte directement des moyens, l’IPEV sera, d’ici fin 2026 et à l’image de la Flotte océanographique française, labellisé très grande infrastructure de recherche (IR*) et intégré à l’Ifremer sous la forme d’une direction dédiée.
François Houllier, président-directeur général de l’Ifremer : « L’Ifremer s’attelle à ce que la nouvelle direction de l’Institut polaire français continue de déployer, dans les meilleures conditions, ses compétences, ressources et moyens au service de la recherche scientifique dans les régions polaires. Comme nous le faisons avec l’IR* Flotte océanographique française, que nous opérons depuis 2018 au bénéfice de toute la communauté scientifique, nous travaillerons main dans la main avec les universités et les organismes nationaux et internationaux qui s’appuient sur l’Institut polaire. C’est essentiel alors que la recherche polaire a besoin d’accélérer ses travaux pour comprendre les phénomènes en cours aux pôles sous l’effet des changements globaux, qui je le rappelle, ont des conséquences majeures sur l’Océan mondial ».
David Renault, directeur de l’Institut polaire français : « Les régions polaires connaissent de profonds bouleversements ayant des répercussions majeures aux échelles locales, régionales et globales, et à différentes échelles temporelles. La cryosphère, par exemple, joue un rôle clé dans la régulation du climat et la préservation de la biodiversité, et sa fonte a des effets critiques sur le niveau des océans et la circulation thermohaline. Notre compréhension des conséquences environnementales de ces changements nécessite donc une meilleure prise en compte de leurs effets emboités au sein de continuum « terres polaires – océan ». Cette alliance stratégique Institut polaire – Ifremer permettra de décloisonner les recherches, et décuplera le potentiel scientifique français dans un cadre « One Environment ».
Pour que la France reste pionnière en termes de recherche dans et sur les mondes polaires
Acteur de premier plan dans la recherche sur les pôles, le CNRS a dévoilé le 9 juin, au nom de son agence de programme, la synthèse de la première prospective sur la recherche scientifique française aux pôles. Présenté lors de la troisième conférence des Nations unies pour l’océan (Unoc-3), à Nice, ce document marque un engagement ambitieux pour les années à venir et souligne le besoin de moyens renforcés pour la science dans et sur les mondes polaires.
Antoine Petit, président-directeur général du CNRS :
« La science polaire est un fleuron de la recherche française. Elle doit constituer un volet majeur de la diplomatie polaire française telle qu'elle est incarnée dans la stratégie polaire portée par l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor. Pour cela elle peut s'appuyer sur les capacités remarquables de l'Institut polaire français qu'il faut renforcer pour pérenniser sa capacité de projection et d'accompagnement des scientifiques aux deux pôles. La recherche polaire doit également bénéficier d'une coordination nationale qui permettra de mettre en synergie tous les acteurs, organismes, universités et ministères, concernés par la recherche polaire. Le CNRS est fier de porter cette ambition pour l'ensemble de la communauté et s'attachera à défendre et impulser les ambitions portées par la prospective polaire française qu'il vient de rendre publique. »